« Droit de mourir, suicide assisté : regards croisés sur la fin de vie ». Tel était l’intitulé de la conférence ayant clôt le 35èmecongrès de la FNADEPA, un événement 100 % numérique qui s’est tenu les 5 et 6 octobre derniers. Invités à intervenir, la philosophe et formatrice en IFSI Julie Soustre, l’avocate belge Me Jacqueline Herremans et le responsable de l’équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs du CHU de Rennes, le Pr Vincent Morel, ont confronté leur vision du sujet et les questionnements éthiques qui en découlent.
France v/s Belgique : deux visions opposées ?
Partant du principe que la législation représente le premier paramètre à prendre en compte avant de considérer cet enjeu délicat, le Pr Vincent Morel a commencé par rappeler les différentes lois adoptées en France pour accompagner la fin de vie. Accès aux soins palliatifs en 1999, refus de l’acharnement thérapeutique en 2005, encadrement de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès en 2016… Pour cet expert, qui préside par ailleurs le conseil scientifique de la Société Française d’Accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), ce sont là « des progrès indéniables pour la médecine ». « Quand j’étais à l’université, on ne parlait même pas de soins palliatifs », rappelle le médecin qui concède toutefois « qu’aucuneloi ne pourrait clôturer le débat ».
Un constat auquel nos voisins belges ne peuvent que souscrire, alors même que l’euthanasie y est autorisée depuis près de deux décennies. Pour autant, les lois de 2002 relatives aux soins palliatifs, à l’euthanasie et aux droits des patients n’ont, elles non plus, pas mis fin aux débats. Pour Jacqueline Herremans, également présidente de l’association belge « Pour le droit de mourir dans la dignité », l’approche mise en œuvre outre-Quiévrain permet surtout« d’engager la discussion ». « Aujourd’hui en Belgique, une personne qui dit “Je suis fatiguée de vivre”, ne peut pas avoir de réponse favorable automatique, explique l’avocate. Trois conditions sont requises pour valider le processus. Il doit s’agir d’une demande volontaire, réfléchie et sans pression extérieures. Le patient doit aussi être atteint d’une affection grave et incurable. Sa situation doit, enfin, être sans issue et engendrer des souffrances physiques ou psychologiques ».
Un constat auquel nos voisins belges ne peuvent que souscrire, alors même que l’euthanasie y est autorisée depuis près de deux décennies. Pour autant, les lois de 2002 relatives aux soins palliatifs, à l’euthanasie et aux droits des patients n’ont, elles non plus, pas mis fin aux débats. Pour Jacqueline Herremans, également présidente de l’association belge « Pour le droit de mourir dans la dignité », l’approche mise en œuvre outre-Quiévrain permet surtout« d’engager la discussion ». « Aujourd’hui en Belgique, une personne qui dit “Je suis fatiguée de vivre”, ne peut pas avoir de réponse favorable automatique, explique l’avocate. Trois conditions sont requises pour valider le processus. Il doit s’agir d’une demande volontaire, réfléchie et sans pression extérieures. Le patient doit aussi être atteint d’une affection grave et incurable. Sa situation doit, enfin, être sans issue et engendrer des souffrances physiques ou psychologiques ».
Quel rôle pour le médecin ?
Dans le cadre strict posé par la loi belge de 2002, le médecin joue un rôle central : il engage la discussion avec le patient et sa famille avant d’être, le cas échéant, celui qui réalise l’acte. Le système belge diffère ici de celui appliqué en Suisse, lequel prévoit l’intervention d’équipes spécialisées. Pour Jacqueline Herremans, ce choix s’explique avant tout par la volonté de « garder le médecin au centre du processus », afin qu’il puisse offrir « une mort douce ».« Quelle est la différence entre une sédation terminale, un arrêt de traitement que l’on sait fatal et une injection létale ? », s’interroge l’avocate sans faire de réelles distinctions éthiques entre ces pratiques.
Mais force est de constater que c’est là un point d’achoppement, car une partie de la population, y compris au sein du corps médical, ne partage pas ce point de vue. « Mon appréciation de la question éthique est différente entre une sédation et une injection, qui ne font pas appel aux mêmes repères. Personnellement, je veux soulager la mort et non l’accélérer », confie par exemple le Pr Vincent Morel. Malgré cette position différente, le médecin français rejoint toutefois l’avocate belge sur un point : « il est important que le médecin soit au centre de la démarche ». Mais, admet-il, et bien qu’un tel fonctionnement puisse sans conteste simplifier le dialogue entre les professionnels de santé et le patient, il peut aussi être « difficile à assumer ».
Mais force est de constater que c’est là un point d’achoppement, car une partie de la population, y compris au sein du corps médical, ne partage pas ce point de vue. « Mon appréciation de la question éthique est différente entre une sédation et une injection, qui ne font pas appel aux mêmes repères. Personnellement, je veux soulager la mort et non l’accélérer », confie par exemple le Pr Vincent Morel. Malgré cette position différente, le médecin français rejoint toutefois l’avocate belge sur un point : « il est important que le médecin soit au centre de la démarche ». Mais, admet-il, et bien qu’un tel fonctionnement puisse sans conteste simplifier le dialogue entre les professionnels de santé et le patient, il peut aussi être « difficile à assumer ».
L’épineuse question des choix individuels
Pour toujours mieux accompagner les professionnels de santé et les proches, et surtout pour s’assurer que la volonté du patient sera bien entendue, la Belgique développe actuellement un projet de soins personnalisé et anticipé dans les EHPAD. Comparable aux directives anticipées mises en œuvre en France, il vise à prévoir et inscrire les souhaits de chaque résident en matière de soins et/ou de refus de traitement, en situation de fin de vie comme d’incapacité temporaire. « Ces projets font la parfaite convergence entre les demandes des soignants en termes d’informations, et celles des résidents à être entendus », explique Jacqueline Herremans, en précisant qu’ils « restent évolutifs et peuvent être modifiés à tout moment ». En France, on l’a dit, les directives anticipées permettent d’effectuer une démarche similaire. Introduites par la loi Léonetti de 2005, elles ne sont pourtant adoptées que par une minorité de personnes.
« 10 à 15 % de la population qui remplit ce type de papiers, c’est pour moi le maximum, car la démarche n’est pas aisée », note le Pr Vincent Morel. « Ces formulaires, qui portent uniquement sur des éléments rationnels, sont difficiles à renseigner, abonde Julie Soustre. La plupart de ceux qui y souscrivent se demandent d’ailleurs s’ils ne changeront pas d’avis ».Partant de ce constat, la philosophe s’interroge sur les raisons de vivre – qui peuvent fluctuer suivant les périodes –, mais aussi sur la responsabilité d’une décision de fin de vie, en particulier en présence de troubles cognitifs. Cette dernière question lui permet de faire le lien avec les enjeux révélés par la crise sanitaire ; elle renvoie, dit-elle, à la place des personnes âgées et fragilisées dans une société dont « le discours très autonomiste conduit à les exclure ».
Article publié dans le numéro de janvier d'Ehpadia à consulter ici
« 10 à 15 % de la population qui remplit ce type de papiers, c’est pour moi le maximum, car la démarche n’est pas aisée », note le Pr Vincent Morel. « Ces formulaires, qui portent uniquement sur des éléments rationnels, sont difficiles à renseigner, abonde Julie Soustre. La plupart de ceux qui y souscrivent se demandent d’ailleurs s’ils ne changeront pas d’avis ».Partant de ce constat, la philosophe s’interroge sur les raisons de vivre – qui peuvent fluctuer suivant les périodes –, mais aussi sur la responsabilité d’une décision de fin de vie, en particulier en présence de troubles cognitifs. Cette dernière question lui permet de faire le lien avec les enjeux révélés par la crise sanitaire ; elle renvoie, dit-elle, à la place des personnes âgées et fragilisées dans une société dont « le discours très autonomiste conduit à les exclure ».
Article publié dans le numéro de janvier d'Ehpadia à consulter ici
La dignité sous le prisme de la philosophie
« On ne peut pas, objectivement, répondre à la question “Qu’est-ce que bien mourir ?” », a rappelé Julie Soustre, appelant plutôt à s’interroger sur les concepts de « droit » et de « dignité ». Sur ce dernier point, les philosophes se sont déjà largement attachés à tenter de définir le concept de dignité. Pour Julie Soustre, deux propositions peuvent être retenues : la dignité peut, en premier lieu, être vue comme « la hauteur à laquelle je dois me hisser en tant qu’être humain ».« Dans ce contexte, je mourrais toujours dans la dignité », explique-t-elle. Mais une seconde conception est possible, en rapprochant le concept de dignité de celui relatif au « sentiment de décence »,« à ce que l’autre me renvoie », ce qui modifie radicalement notre vision de la fin de vie. Articuler ces approches et les coupler au thème « non-anodin qu’est la mort »représente, pour la philosophe, l’un des fondements de ce débat « et de sa vigueur ».
« On ne peut pas, objectivement, répondre à la question “Qu’est-ce que bien mourir ?” », a rappelé Julie Soustre, appelant plutôt à s’interroger sur les concepts de « droit » et de « dignité ». Sur ce dernier point, les philosophes se sont déjà largement attachés à tenter de définir le concept de dignité. Pour Julie Soustre, deux propositions peuvent être retenues : la dignité peut, en premier lieu, être vue comme « la hauteur à laquelle je dois me hisser en tant qu’être humain ».« Dans ce contexte, je mourrais toujours dans la dignité », explique-t-elle. Mais une seconde conception est possible, en rapprochant le concept de dignité de celui relatif au « sentiment de décence »,« à ce que l’autre me renvoie », ce qui modifie radicalement notre vision de la fin de vie. Articuler ces approches et les coupler au thème « non-anodin qu’est la mort »représente, pour la philosophe, l’un des fondements de ce débat « et de sa vigueur ».


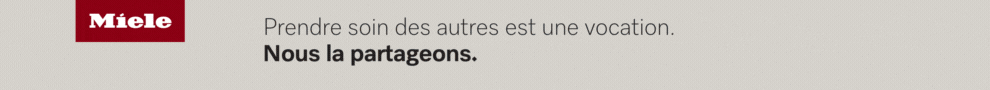


 MoliCare®, des changes pensés pour les résidents et les soignants
MoliCare®, des changes pensés pour les résidents et les soignants